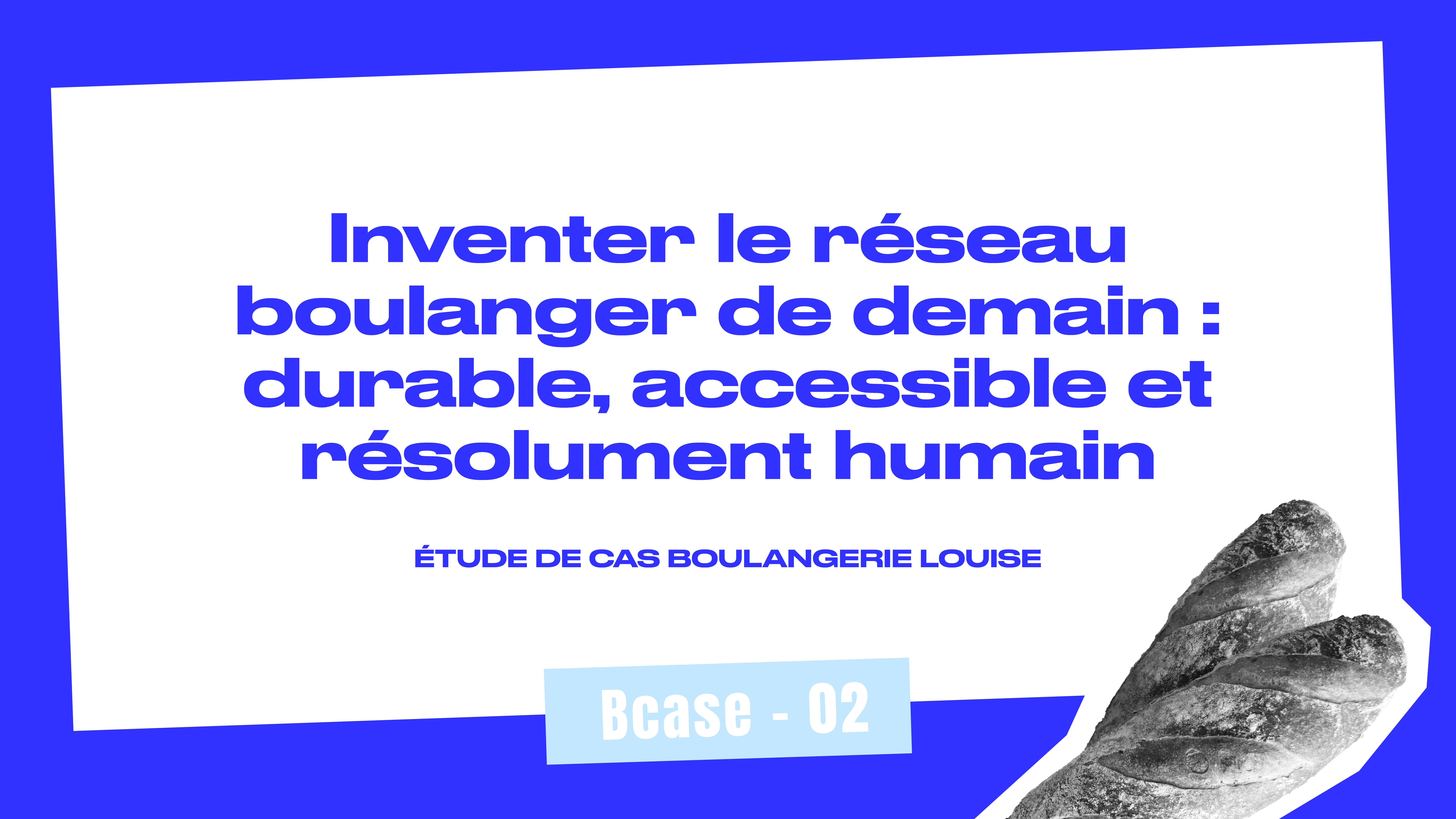
Devenir leader de son secteur en alliant engagement et vision stratégique
Que mettrons-nous dans nos assiettes dans 5 ans ? Connaîtrons-nous la fin du saumon en No...
janvier 2024
Tout secteur

Belleville Talks #2 : Un débat avec Pierre Hurstel et Vincent Meyer animé par Apolline Dumont
Auteur de littérature contemporaine, Michel Houellebecq construit une vision panoramique du travail. Il y aborde de nombreux milieux professionnels : l’informatique, la recherche, le tourisme, le showbiz, l’artistique, l’universitaire, ou encore l’agriculture…
Ce panorama du monde de l’entreprise et du travailleur place Houellebecq comme un fin observateur des entreprises.

Michel Houellebecq dévoile les travers de nos sociétés et en particulier du consumérisme.
Il décrit notamment un monde du salariat liquide en faisant référence à la société liquide de Zygmunt Bauman. Une société où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’actions pour se figer en habitudes et en routines. Tout devient liquide, il n’y a plus d’institution fixe, le changement et les transformations sont continus.
Le « salariat liquide » se définit sur trois piliers :
Dans cette société liquide, Houellebecq dépeint une notion de temps qui disparaît tant il est accéléré et où le geste se perd par la digitalisation des tâches et l’avènement du secteur tertiaire. Le travail se dématérialise, le temps se dissout dans une course folle.
C’est pourquoi cette société liquide met à profit les compétences – et en particulier celles d’adaptation – plus que les qualifications techniques qui deviennent obsolètes en un claquement de doigts.
À travers la vision consumériste appliquée au travail, Houellebecq pose la question de notre rapport au travail. Entre société liquide et société solide, n’y a-t-il pas une nuance où le geste, les compétences et les qualifications ont une place équivalente ?
L’artisanat c’est revenir à l’essence du travail pour Houellebecq : l’individu est responsable d’une tâche du début à la fin, la conception et l’exécution ne sont jamais séparées, la tête et la main sont réconciliées.
Le modèle artisanal repense d’ailleurs le travail autour d’une matérialité. Houellebecq y défend une idée de progrès lent, plus qualitatif et offre de multiples perspectives pour réinventer le monde du travail à travers le modèle de l’artisanat.
L’acteur principal de ce modèle artisanal, l’individu – artisan possède alors trois intelligences
Le concret, la connexion avec le faire, la matérialité et la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production sont des pistes de réflexion pour redonner du goût au travail.
Il est intéressant de noter d’ailleurs le retour en grâce du modèle artisan dans les aspirations professionnelles des Français. Selon une étude de l’institut des métiers de 2014, le nombre de créateurs d’entreprises artisanales issus de l’enseignement supérieur a augmenté́ de presque 50% entre 2009 et 2013. En 2016, un tiers des entrepreneurs étaient des artisans et on comptait 150 000 apprentis dans l’artisanat en 2020. En 2021 encore, les métiers manuels et de l’artisanat arrivent en tête des professions vers lesquelles les cadres souhaitent se reconvertir (46% des répondants d’une étude de Michael Page). Et s’ils ne sont qu’une minorité à franchir le pas, celle-ci s’accroît au fil des années : sur les 130 000 adultes que la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) a formés pendant l’année 2020. Or, le travail artisanal a de singulier que le travailleur maîtrise l’ensemble de la chaîne de production et qu’il peut choisir ses outils et la manière dont il souhaite les manipuler. Le travail artisan de la main est indissociable de l’intelligence et l’artisan est capable de créativité (Sennett ; 2010). Une souveraineté́ retrouvée sur le travail et la manière de l’exécuter qui font écho aux aspirations d’autonomie des Français.
Le monde de l’entreprise peut être vertueux s’il possède trois qualités :
« Il n’y a pas de planète B mais il n’y a pas de people B non plus. » – Pierre Hurstel
Bien que le modèle de l’entreprise durable et le modèle lent de l’artisanat semblent s’opposer dans les discours, avec d’un côté la performance industrialisée et de l’autre la singularité du geste, la contribution humaine dans nos organisations peut être repensée pour rapprocher ces deux visions.
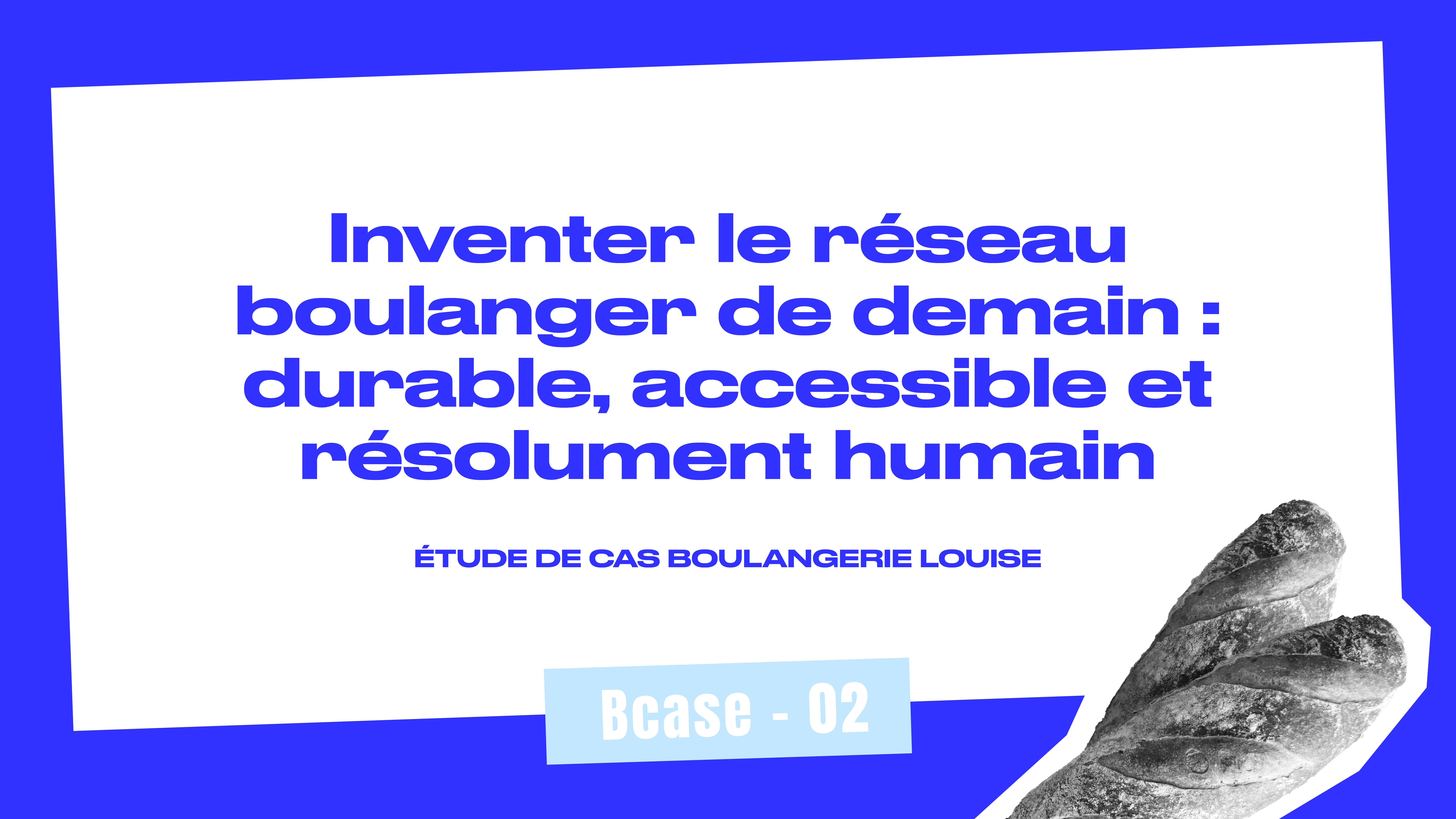
Que mettrons-nous dans nos assiettes dans 5 ans ? Connaîtrons-nous la fin du saumon en No...
janvier 2024
Tout secteur

Alexandra Bidet est sociologue, chargée de recherches au Centre national de la recherche ...
septembre 2023
Tout secteur